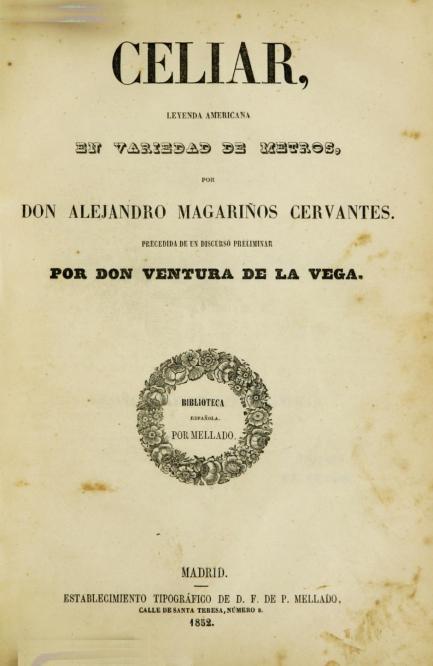María Helena Barrera-Agarwal
« Je constate, avec amertume, qu’il ne reste plus que quelques gouttes de sang dans les artères de nos époques phtisiques. Depuis les pleurnicheries odieuses et spéciales, brevetées sans garantie d’un point de repère, des Jean-Jacques Rousseau, des Châteaubriand et des nourrices en pantalon aux poupons Obermann, à travers les autres poètes qui se sont vautrés dans le limon impur, jusqu’au songe de Jean-Paul, le suicide de Dolorès de Veintemilla, le Corbeau d’Allan, la Comédie Infernale du Polonais, les yeux sanguinaires de Zorilla, et l’immortel cancer, Une Charogne, que peignit autrefois, avec amour, l’amant morbide de la Vénus hottentote, les douleurs invraisemblables que ce siècle s’est créées à lui-même, dans leur voulu monotone et dégoûtant, l’ont rendu poitrinaire. Larves absorbantes dans leurs engourdissements insupportables !»
Poésies, I, 27
- Introduction
Dans le paragraphe de Poésies cité, seuls deux auteurs appartiennent à la littérature en langue espagnole, « Dolores de Veintemilla » et « Zorilla ». Contrairement à d’autres écrivains évoqués par Ducasse, déterminer leur identification exacte n’a pas été une tâche simple. L’identité de Dolores Veintimilla et la manière probable dont son nom et son suicide ont fini par paraitre dans les pages de Poésies, ont été les sujets d´une élucidation complexe. Une complexité semblable s´est présentée à l’égard du « Zorilla » et du détail qui accompagne ce nom, la référence apparemment impossible à comprendre : « les yeux sanguinaires ».
Depuis de plus d’un siècle, on essaye de clarifier la portée de ces mots. Valery Larbaud les trouva si impénétrables qu’il suggéra la possibilité d’une erreur typographique – l´introduction du mot « yeux » au lieu de « dieux ».[1] La plupart des critiques ont cependant accepté la validité du texte, en supposant toujours que l’écrivain cité est José Zorrilla y Moral, le poète espagnol romantique le plus célèbre à l’époque où Lautréamont écrit son livre.[2] Toutefois, aucune preuve n’a été trouvée pour justifier une telle spéculation. Zorrilla ne fait pas mention d’ yeux « sanguinarios », « sangrientos » ou « sanguinolentos » – choix également possibles en espagnol. La raison pour laquelle Ducasse a choisi « Zorilla » pour l’intégrer à son texte, et, de plus, le sens de l’expression « les yeux sanguinaires » qu’il lui attribue, sont donc demeurés un mystère.
La présente note propose une théorie qui pourrait confirmer l’identification de José Zorrilla y Moral comme le «Zorilla» de Poésies. Elle cherche à justifier cette identification par des preuves qui établissent la relation d’amitié entre Zorrilla et un écrivain uruguayen, Alejandro Magariños Cervantes. Elle pose, en bref, que Ducasse connaissait l’existence des éditions originales de deux ouvrages publiés par ces auteurs, et que le contenu de ces oeuvres et les liens entre leurs auteurs fournissent un contexte et une explication à l’obscure allusion présente dans Poésies.
- La Rosa de Alejandría
En 1852, Alejandro Magariños Cervantes, jeune uruguayen de vingt-sept ans, publie un livre à Madrid. Intitulé Celiar, leyenda americada en varios metros[3] (« Celiar, légende américaine sur plusieurs mètres »), c’est une histoire de caractère romantique, écrite en vers[*]. L’intrigue est clairement influencée par les thèmes de Chateaubriand. Un élément, cependant, cherche à tempérer le caractère trop connu de ces créations : Magariños remplit son travail de détails vernaculaires, produisant ainsi une impression exotique apte à susciter l’intérêt du public européen. Ces éléments se manifestent dans le texte et dans les illustrations contenues dans le livre – richement orné pour mettre en évidence les attributs uniques des latitudes américaines.[4]
Le mérite littéraire de Celiar est très relatif. Cependant, l’œuvre connaîtra un succès considérable en son temps.[5] Ce succès doit être compris à la lumière de deux faits, sa publication en Espagne, et les hommages reçus des auteurs les plus reconnus à l’époque. L’édition originale de Celiar est précédée d’un préambule très élogieux, rédigé par le déjà célèbre Ventura de la Vega. Plus significatif encore, en 1854, quelques mois après la parution du livre, le poète espagnol José Zorrilla y Moral dédiait à Magariños une de ses œuvres, La Rose d’Alexandrie,[6] en mentionnant dans le prologue qu´il s’était inspiré de Celiar pour l’écrire:
«La lecture de votre Celiar, que je ne connaissais pas, a été la source qui m’a fourni l’eau qui a arrosé la terre pour planter ma Rosa : son inspiration, donc, nous appartient à parts égales. »[7]
Cette effusion de Zorrilla est due, probablement et en grande partie, à son amitié avec Magariños. La preuve de cette relation est simple à retrouver : la première édition de La Rosa de Alejandría apparaît dans la Revista española de ambos mundos,[8] une revue fondée par l’Uruguayen à Madrid. Dans le prologue, Zorrilla explique comment Magariños avait manifesté son admiration explicite à son égard, bien avant de le rencontrer personnellement. Il mentionne aussi la manière dont Magariños avait insisté pour que Zorrilla lui cède un texte à publier dans sa revue, en lui envoyant une lettre, qu’il transcrit intégralement.
- Celiar et «les yeux sanguinaires ».
Lorsque Zorrilla fait publier La Rosa de Alejandría sous forme de livre, en 1857, il n’y inclut pas le prologue qui concerne Magariños. Néanmoins, on peut supposer que Magariños s’est assuré que tant Celiar que le volume de La revista española de ambos mundos contenant le prologue de Zorrilla a son égard, aient la plus large circulation possible parmi les élites intellectuelles de l’Amérique Latine. Ceci est évident, notamment en ce qui concerne son pays d’origine, l’Uruguay. En 1878, dans un article consacré à Magariños, son contemporain et ami Jose Antonio Tavolara souligne comment :
«Le jugement littéraire placé par D. Ventura de la Vega dans l’édition illustrée de Celiar, suffit à établir la réputation de n’importe quel écrivain. L’ éminent poète José Zorrilla lui a dédié la belle légende La Rosa de Alejandría, inspirée par la lecture de Celiar, comme l’indique une lettre amicale « .[9]
Au-del même du dix-neuvième siècle, l’histoire va se répandre encore, comme une marque de prestige :
« Dans le Celiar de Magariños Don Jose Zorilla a trouvé l’inspiration pour écrire La Rosa de Alejandría, qui est dédié à l’Uruguayen. »[10]
A son retour en Uruguay, en 1855, Magariños possède déjà une grande influence. En plus de sa renommée en tant qu’auteur – fondée, comme on l’a vu sur les éloges de deux des poètes européens, les plus renommés de l’époque, – Magariños a obtenu en Espagne une solide formation juridique. Pour le reste de sa vie, ces deux avantages vont se concrétiser en succès. Professionnellement, Magariños détiendra des élevées publiques positions dans son pays. Littérairement, il se placera comme l’un des leaders du romantisme en Uruguay, pays où il deviendra une figure omniprésente :
« Dans ses nombreuses années de vie, il jouit de tous les honneurs et dignités… Juge, ministre, professeur de droit et président de l’Université de Montevideo, membre correspondant de l’Académie Espagnole. Il est loué par ses pairs et admiré des jeunes. En Amérique Sarmiento Gutierrez, Bilbao, Mármol, Baralt étudient son oeuvre. En Espagne, Larra, Castelar, Zorrilla, Canovas ».[11]
Ducasse devait connaître l’existence de Magariños, en raison de la prééminence de ce dernier sur la scène littéraire uruguayenne dans les décennies des années cinquante et soixante du XIXe siècle. Est-ce qu’il a lu Celiar ? Est-il au courant des louanges de Zorrilla ? Il est impossible de le prouver avec une certitude absolue, en l’absence d’un témoignage direct. Cependant, un détail laisse penser qu’une telle hypothèse est fondée : à la page 73 de l’édition originale de Celiar, après une vignette d’un serpent à sonnettes, et dans le cadre de la description d’une nature aussi artificielle que romantique, on lit ce qui suit :
¿O acaso vaga en la selva
algún cimarrón famélico,
y en el disco de la luna
clava sus ojos sangrientos,
tiende el cuello, el aire aspira,
y hacia el llano dirigiéndose
con triste, fúnebre aullido
convoca a sus compañeros
para caer como hienas
sobre el ganado indefenso?[12]
En lisant ces vers et d’autres de même tonalité, il est difficile de croire que Zorrilla y a trouvé l’occasion de célébrer Celiar, et, qui plus est, de déclarer qu’il y a glané de l’inspiration. Le passage confirme le mérite relatif de Magariños en tant que poète. Les platitudes peu attirantes de ces vers sont à peine tempérées par un terme américain – «cimarrón» pour «perro salvaje» – expliqué dans l’abondant glossaire qui accompagne Celiar. Dans ce contexte, l’expression «les yeux sanguinaires» revêt un intérêt tout particulier. Forcée et excessive, elle apparaît de manière paradoxalement mémorable dans le contexte du poème.
- Conclusion
Considérant la présence de l’expression «les yeux sanguinaires» dans Celiar, et le rapport entre Magariños et Zorrilla – notables représentants de l’école romantique abhorrée par Ducasse – il devient possible d’interpréter le passage de Poésies comme une double allusion. La plus évidente, bien sûr, touche Zorrilla lui-même et son oeuvre. La seconde, cryptique, concerne Magariños, sa trajectoire irrésistible, ses victoires littéraires sur deux continents, obtenues en dépit de la précarité de son talent poétique. Béni par Zorrilla, élevé à des positions qui se maintiendront toujours hors d’atteinte pour le jeune Ducasse, Magariños se trouve réduit dans les œuvres de ce dernier à figurer une ombre dans l’ombre de Zorrilla – dernière et extrême destination.
L’intérêt d’une possible allusion à Magariños va au-delà de la simple inclusion d’un passage cryptique dans les Poésies. Il permet de spéculer sur les lectures et l’environnement intellectuel avec lesquels Ducasse a pu être en contact en Uruguay.
L’une des sources possibles des données recueillies par Ducasse sur Dolores Veintimilla est la brochure intitulée Dos poetas, apuntes de mi cartera,[13] par l’auteur péruvien Ricardo Palma. Cette publication contient deux articles – le texte sur la poétesse équatorienne, précédé d’un essai sur le poète argentin Juan Maria Gutierrez. Dans ce dernier texte, Palma mentionne expressément Magariños, à deux reprises, en précisant qu’il l’a aidé avec des données biographiques sur Gutierrez. Il est donc possible de déduire de cette déclaration que Magariños est un bon ami de Gutiérrez et de Palma. Cela permet de supposer que les livres et les brochures du péruvien ont pu trouver place dans la bibliothèque du uruguayen.
La présence de Magariños a également un intérêt pour ses rapports – à la fois personnels et familiaux – avec la France et les milieux diplomatiques uruguayens. En 1853, Magariños est à Paris, où il publie deux de ses livres. En 1854, il est secrétaire de la délégation de l’Uruguay auprès du gouvernement français, mission diplomatique dirigée par son oncle, Francisco de Borja Magariños, en tant que ministre plénipotentiaire. En 1869, Alejandro détient brièvement le portefeuille des Affaires étrangères de l’Uruguay.
Son cousin, Mateo, fils de Francisco, est également nommé ministre des Affaires étrangères de l’Uruguay en 1854 et 1876. Il exerce aussi comme chargé d’affaires de l’Uruguay à Paris, après octobre 1871. Une des filles de Mateo, Matilde, épouse Louis Edouard Fernand, Comte de la Tour de Saint-Igest. Sans doute du fait de cette relation, le Comte a servi comme consul général de l’Uruguay au Havre, à partir de 1876.
[1] Larbaud, Valery, Les Poésies d’Isidore Ducasse, La Phalange, 20 Février 1914, pp. 148
[2] Une exception notable à cette hypothèse est celle proposée par Jean-Pierre Lassalle, qui suggère que Lautréamont pourrait se référer à Francisco de Rojas Zorrilla, poète espagnol du XVIIe siècle. Lassalle, Jean Pierre, La bibliothèque du lycée de Pau, dans Daniel Lefort et Jean-Jacques Lefrère (éd)., Lautréamont et Laforgue dans leur siècle, Actes du IIe colloque Lautréamont et Laforgue, Tarbes-Pau, 21-24 septembre 1994, Cahiers Lautréamont, XXXI-XXXII, 1994. Lassalle fait valoir que la mention « les yeux sanguinaires » peut se comprendre comme une allusion à la pièce « No hay ser padre siendo rey », dans laquelle l’on trouve des scènes où des yeux sont arrachés. Cette possibilité, cependant, ne tient pas. Elle impliquerait une allusion sans aucun lien avec l’espace temporel expressément désigné par Ducasse – « les douleurs invraisemblables que ce siècle s’est créées à lui-même » (soulignement ajouté). Chacun des auteurs mentionnés par Ducasse a été actif dans cette période. En outre, il aurait été très difficile que Ducasse parle du poète en utilisant le nom de famille de sa mère, Zorrilla, au lieu du patronyme Rojas.
[3] Magariños Cervantes, Alejandro, Celiar, leyenda americana en variedad de metros, Establecimiento Tipográfico de D. F. de P. Mellado, Madrid, 1852
[4] Les illustrations ont été exécutées par l’ artiste reconnu Vicente Urrabieta y Ortiz.
[5] À partir du début de Décembre 1852, Celiar sera publié en feuilleton dans le quotidien La Nación, de Madrid. Margariños Cervantes, Alejandro, Celiar, dans La Nación, quatrième année, n ° 1040, 1er Décembre 1852, Madrid, p. 1. Le même journal a publié un peu plus tôt, également sous forme de feuilleton, Caramurú, roman de Magariños, et diffusera de nombreux commentaires et notes admiratifs concernant l’auteur uruguayen.
[6] Zorrilla y Moral, José, La rosa de Alejandría, leyenda, dans La revista española de ambos mundos, Tomo Segundo, Establecimiento Tipográfico de Mellado, Madrid, 1854, en deux livraisons, (I) p. 230, y (II) p. 354.
[7] Ídem, ibidem, p. 231
[8] Zorrilla y Moral, José, La rosa de Alejandría. Leyenda inédita, original y en verso, Establecimiento tipográfico de Don Francisco de P. Mellado, Madrid, 1857. Le titre présente une curieuse inconsistance : au moment de la publication, en 1857, La Rosa de Alejandría a déjà été publié dans le magazine de Magariños, par l’imprimeur chez lequel il est ensuite publié sous forme de livre. L’insistance sur sa nature inédite et la disparition du prologue sont des détails éloquents, dont la signification exacte doit encore être étudiée.
[9] Tavolara, José Antonio, Escritores uruguayos, dans El Panorama (semanario literario), No. 12, Montevideo, Novembre 24, 1878
[10] García Calderón, Ventura, Barbagelata, H.D., «La literatura uruguaya (1757-1917)», dans la Revue Hispanique, Tome XL, Numéro 97, Librairie C. Klincksieck, Paris, Juin, 1917, p. 457
[11] Ídem, ibídem.
[12] Magariños Cervantes, Alejandro, Celiar, leyenda americana en variedad de metros, op. Cit., p. 73
« Ou peut-être dans la jungle / erre un chien sauvage, avide / et, sur le disque de la lune / fixe ses yeux sanguinaires, / tend le cou, aspirant l’air, / et en se dirigeant vers la plaine / avec un triste, lugubre hurlement / il appelle ses compagnons / à tomber comme des hyènes / sur le bétail sans défense ? »
[13] Palma, Ricardo, Dos poetas, apuntes de mi cartera, Imprenta del Universo de G. Helfmann, Valparaíso,1861
[*] L’édition originale de Celiar est accessible en ligne sur le site du Ministère espagnol de la Culture : Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico: http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=451124 (Note de l’Éditeur)